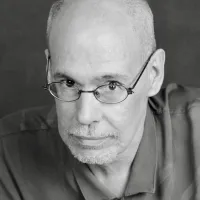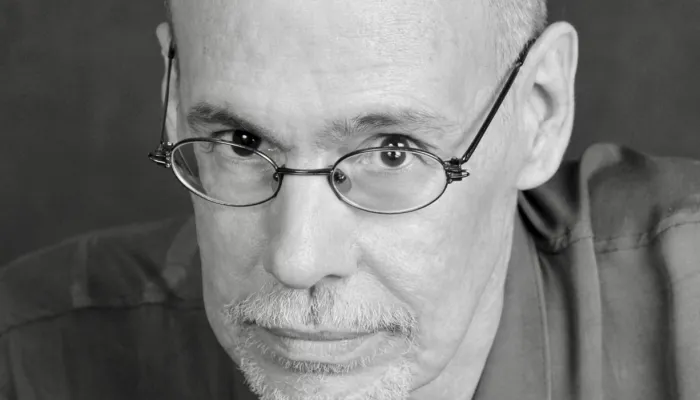La faim me réclame, la faim incommensurable,
la faim excitée par le flottement continu
des étoiles. Elle vient, ma faim, empourprer
mes veines afin de dessiner le bonheur
après la tristesse. Mais le bonheur comme
la tristesse demeurent imprévisibles (on
ne s’y prend jamais d’avance avec le bonheur,
la tristesse). Tantôt, ma tristesse, je
l’ai dit ou le dirai, mâche toutes mes
flèches, ma tristesse est synonyme d’un
rétrécissement. Il y a sans cesse au cours
de la vie un élément de mal compris qui
vous hante et occasionne des contretemps.
Quelque chose comme un souvenir enlisé,
un souvenir soumis tous les matins aux
exigences d’une image qui n’a pas changé.
Est-ce qu’on se sent coupable de trahir
un souvenir? Est-ce qu’on se raconte des
vérités, des mensonges, en s’imaginant
le serrer contre son cœur ou le retenir
au bas d’un escalier? Nous progressons
de pair avec ce souvenir, au gré des
chambres, trouvant dans chaque chambre
plein d’objets pour savoir et pour croire,
plein d’objets ayant appartenu à des
personnes (tantôt vieillis, tantôt utiles).
À l’aide de ces objets parfois, on invoque
des personnes plusieurs fois, celles qui
vivent comme celles qui ne vivent pas.
On allume des bougies, on perçoit le
battement d’une horloge, la chambre se
réanime et semble irrévocable. Le contraire
est une pente abrupte, un choc corporel :
le silence déchirant le silence, le
terrible messager incinéré sur la grève,
la mort du poème… Qu’est-ce qui se
dévoile aux confins d’une chambre si
l’on y trébuche soudain, si le fait de
voir n’élimine pas ce qu’on ne voit pas?
Qu’est-ce qui compte ou ne compte pas
et surnage à la surface de nos voix
à ce moment-là?
François Charron, « La mort du poème », La chambre des miracles, Les Herbes rouges, 1994, p. 83-84.